Ebauche d'une autobiographie...
Mireille Warschawski
(2006)
Première partie
(1924-1945):
Entre
deux guerres...
La
guerre commence
Notre vie à Paris sous l'occupation
allemande
Entre deux
guerres...
Je suis née 6 ans après la fin de la « grande guerre » (14-18). J’ai
mis longtemps à m’apercevoir qu’à quelques années près j’aurais pu
naître Allemande, comme mes parents. J’ai eu la chance de naître à une
époque où le monde commençait à s’ouvrir largement aux familles des
couches moyennes. Nous étions à une époque de mobilité sociale. J’ai
aussi eu la chance de vivre dans différents milieux juifs, qui se
disaient tous religieux, mais qui étaient plus ou moins fermés (ou
ouverts) à ceux qui ne pensaient pas comme eux.
Mes parents sont nés dans deux villages d’Alsace, à quelques kilomètres
l’un de l’autre. Papa est né à Osthouse, communauté mère de celle où
est née maman: Erstein. Ils étaient tous les deux descendants de
familles juives établies en Alsace depuis 1700, au moins. Une seule
autre famille juive habitait encore Osthouse à l’époque de ma naissance.
Je n’ai pas connu mes grands-parents
paternels. À cette époque, il était assez rare qu’un enfant ait la
chance de connaître ses deux grands-pères et ses deux grands-mères.
Papa avait un frère, l’oncle Adolphe, et une sœur, tante Louise, tous
les deux plus âgés que lui. Il était l’enfant choyé de la maison et, en
même temps, «l’intellectuel» de la famille, même s’il n’a pas eu la
chance de pouvoir faire des études. Il était un véritable autodidacte.
J’ai bien connu mes grands parents maternels. Ils habitaient Erstein,
communauté récente, et venaient, l’un de Uttenheim, non loin d’Erstein,
l’autre de Niederrœdern, plus au nord de l’Alsace. Mon grand-père
s’appelait Blum et ma grand-mère était une Kauffmann, la famille juive
la plus importante de Niederrœdern. Ils ont eu sept enfants: quatre
filles (dont l’aînée, Coralie, a été déportée), un garçon, puis encore
deux filles. Maman (Hélène) était la seconde, suivie par tante
Juliette, tante Jeanne, oncle Charles, tante
Rose (nous l’appelions Roro) et tante Marthe. Mon grand-père était
marchand de grains, l'un des métiers juifs, comme marchand de bestiaux.
Après sa mort, l’oncle Charles prit la succession. Il était le
personnage principal pour les trois plus jeunes sœurs non mariées
(tante Roro s’est mariée après la guerre).
Les juifs de la région d’Erstein étaient traditionalistes, selon la
tradition de la campagne alsacienne, et d’une ignorance remarquable.
Les femmes ne se couvraient pas la tête, les hommes, sauf exception, se
couvraient la tête uniquement pour faire leurs prières. Je me souviens
qu’ils cherchaient leur casquette avant de se mettre à table, l’ôtaient
quand ils s’étaient lavé les mains et avaient dit la prière au début du
repas, et la remettaient à la fin.
Quand mes parents se sont mariés, ils sont restés quelques années à
Erstein, où je suis née. Mon père était fonctionnaire des «Chemins de
fer d’Alsace et de Lorraine», depuis son retour de la guerre. Il avait
été envoyé sur le front russe et non sur le front français, car l’armée
allemande se méfiait des Alsaciens que l’on soupçonnait trop attachés à
la France. Dès le premier jour, il a été blessé et a fini la guerre à
l’hôpital militaire de Leipzig. Quand l’Alsace est redevenue française,
il savait parfaitement le Français, un Français précieux qu’il avait
appris dans «le Temps», le quotidien des intellectuels. Je me rappelle
avec effroi des rédactions dont il corrigeait le style et qui n’avaient
alors plus rien de spontané. Il adorait l’histoire… et regrettait de ne
pas être devenu journaliste. Pendant la guerre, à Paris, avant mes
examens de baccalauréat, il se promenait avec moi le Shabbat
après-midi, pour me faire réciter mes leçons d’histoire, j’en frémis
encore maintenant! J’étais d’ailleurs la seule des enfants qui avait
droit à ces leçons et, bien plus tard, ma sœur souffrait encore de ne
pas avoir été suivie de la même façon. Il a même commencé à apprendre
le latin lorsque j’étais en 6e, mais il n’a pas tenu le coup longtemps.
En même temps, ma mère a commencé à étudier l’Anglais, comme moi en 6e.
Mon père savait encore parler le Yiddich Daïtch, car je suppose que ses
parents le parlaient. Ma mère ne le savait plus, car seul son père le
parlait encore, mais pas sa mère. Entre eux mes parents parlaient
l’Alsacien, et le Français avec les enfants. Je n’entendais mon père
parler le Yiddich Daïtch qu’avec sa sœur (qui le gâtait), tante Louise
de Metz.
Mes parents ont pris la décision de quitter Erstein un peu avant la
naissance de ma sœur Éliane (née en 1927). J’avais trois ans. Nous
avons alors habité dans un petit appartement (sans salle de bain) à
Strasbourg, rue du Faubourg de Saverne, à quelques minutes du bureau de
papa. Papa était fonctionnaire de ce qui deviendrait quelques années
plus tard, après sa nationalisation, la SNCF (Société Nationale des
Chemins de Fer). Le choix de la synagogue fut un événement important
qui a influencé toute notre vie. La grande « Schoule »
(synagogue en
Alsacien) de Strasbourg était une vraie «Schoule à orgue».
Était-ce la raison pour laquelle mon père se refusait de la
fréquenter ? Je ne le sais pas. Quoi qu’il en soit, Papa
allait tous les Shabbat (samedi) à la prière qui avait lieu à
l’oratoire de l'hôpital Adassa. C’est là qu’il a rencontré Berthold
(Bobi Cohn), membre de la
commission administrative de la communauté Etz’haim, qu’on appelait
aussi «rue Kageneck», du nom de la rue où elle se trouvait. C’était ce
qu’on appelait «une Schoule orthodoxe», régie selon le principe du Rav
Samson Raphaël Hirsch de Frankfort qui, à une époque où les Juifs
s’urbanisaient de plus en plus et où la modernité les éloignait de la
religion, avait fait une synthèse entre modernité et strict respect de
la loi juive. Monsieur Cohn priait le vendredi soir à Adassa, c’était
plus près de sa maison. C’était un homme très cultivé, d’éducation
allemande, professeur d’astronomie à la Faculté de Strasbourg, très
religieux, père de quatre enfants (deux filles et deux garçons). Il a
parlé de Kageneck à Papa, qui a accepté de fréquenter cette Schoule,
dont il s’est rapidement épris et en est devenu membre. Il y a suivi
des cours, y compris de Talmud, et a fini par être élu membre de
l’administration. Quant à maman, elle a accepté de se couvrir les
cheveux en mettant une perruque,
ce qui était une vraie révolution dans la famille.


A
gauche: la "Schoule à Orgue"; A droite: la synagogue de la rue Kageneck
Éliane et moi fréquentions le lycée
de Jeunes Filles, sans écrire le samedi bien sûr. Nous avions, grâce au
concordat, des leçons de
religion chaque semaine. Notre maître était le grand-rabbin Deutsch,
rabbin de Bischheim, place dont Max héritera après la guerre. En 1938,
naquit notre petit frère, Joë. J’avais quatorze ans et Éliane, onze.
Nous faisions également partie d’un mouvement de jeunes religieux,
Yeshouroun. Il était impensable pour mes parents que nous fréquentions
les Éclaireurs Israélites. Yeshouroun faisait partie du mouvement
juif-orthodoxe
Agoudath Israël, pour passer ensuite aux Poalei Agoudath Israël, plus
sionistes. Notre chef était Bô Cohn, le fils du professeur Cohn dont
j’ai parlé plus haut. Quelques mois avant la naissante de Joë, nous
avons déménagé dans un appartement plus bourgeois, 17 avenue des Vosges
et, pour la première fois, nous avions une salle de bains. Jusque là,
on faisait sa toilette journalière dans la cuisine et on prenait un
bain chaque semaine dans un bain public.
L’éducation religieuse reçue à Kageneck était très stricte. Nous avions
des cours
tous les jeudis et tous les dimanches. Même les filles apprenaient pas
mal de choses. Surtout, nous avions appris à mépriser tous les juifs
qui n’étaient pas orthodoxes. Il a fallu attendre la guerre pour
commencer à ne plus vivre repliés sur nous-mêmes. Nous fréquentions les
écoles officielles où nous côtoyions, non seulement des juifs
non-orthodoxes, mais également de nombreux non juifs, qu’ils soient nos
enseignants ou nos camarades d’études. Je voudrais ajouter que je n’ai
jamais eu à me plaindre d’anti-judaïsme. Il ne faut pas oublier qu’en
Alsace, les Juifs et les non Juifs étaient très proches les uns des
autres, surtout dans les campagnes où, depuis des générations, ils
vivaient côte à côte; le judaïsme alsacien était, jusqu’à la
révolution, un judaïsme campagnard. A l'époque, les non juifs d’Alsace
connaissaient la façon juive de vivre, bien mieux que beaucoup
d’Israéliens aujourd'hui.
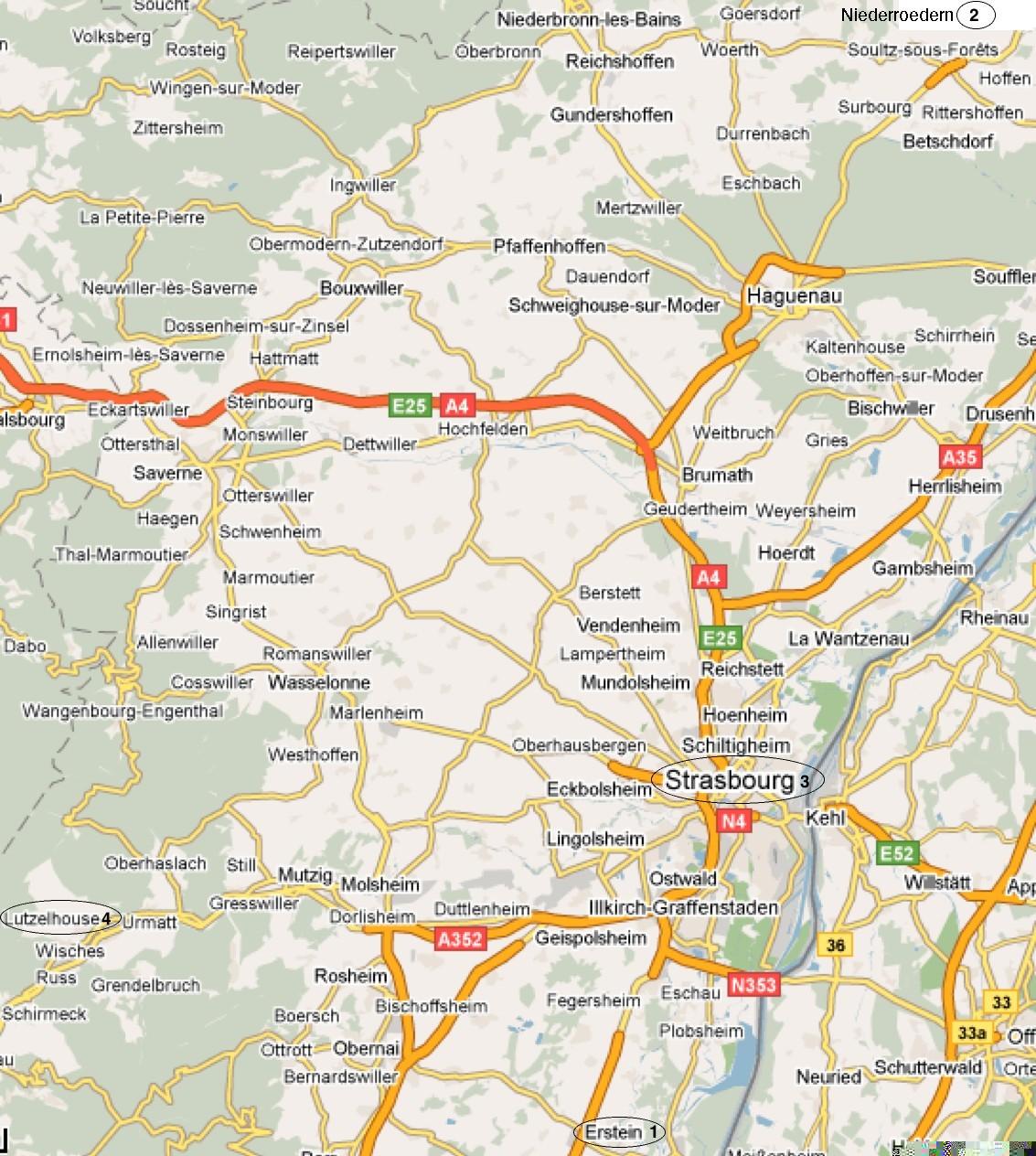
Alsace: (1) Osthouse; Erstein et
Uttenheim ; (2) Niederrœdern ; (3) Strasbourg et
Bischheim ; (4) Lutzelhouse
La guerre commence
Septembre 1939: la guerre avec l’Allemagne hitlérienne commence.
Beaucoup de jeunes gens en début d’études sont mobilisés. Les villes
sur la frontière du Rhin sont évacuées, dont évidemment, Strasbourg.
Nous avons quitté la ville quelques jours avant l’évacuation totale. La
ville est devenue vide, mais les appartements sont restés meublés,
chacun emportant le strict nécessaire. On emmena les Strasbourgeois à
Limoges et à Périgueux et ses environs. Certains choisirent l’endroit
où ils voulaient aller. Papa sera évacué avec son bureau et, en
attendant que nous sachions où ils seront installés, maman ira avec les
trois enfants à Lutzlhouse, petit village des Vosges. Les tantes
d'Erstein sont venues nous rejoindre. Éliane et Mathilde, la petite
Allemande que nous avions prise chez nous, sont allées à l’école des
sœurs du village. Je devais entrer en seconde, mais, comme il n’y avait
pas de seconde là où nous nous trouvions, j’ai perdu un trimestre.
Papa a été prévenu que tout son bureau, lui et ses collègues, juifs et
non-juifs, seraient installés à Hermé, petit village de Seine-et-Marne.
Quand il a eu l’assurance d’y rester, il nous a demandé de le
rejoindre. Il avait, au village, une chambre dans une famille bien
française qui l’a accueilli avec beaucoup de gentillesse et à qui il a
appris ce qu’est être Juif, et Juif pratiquant. Maman a trouvé un
appartement à Provins, place Charles Lenient, et s’y est installée avec
les trois enfants. Provins, chef-lieu de Seine-et-Marne, se trouve à
quelques kilomètres de Hermé, et papa pouvait donc rentrer tous les
soirs à la maison, sauf le vendredi soir. Il faisait même parfois le
chemin à pied, à travers la forêt de la Brie, en compagnie d’un
collègue juif de Strasbourg, Monsieur Jandel. Après l’invasion de la
Belgique par les Allemands, en mai 1940, une véritable hystérie
s’empara des Français. Ils voyaient partout des espions de la «
cinquième colonne ». Un jour, papa et Monsieur Jandel ont été arrêtés
sous prétexte que ces deux Alsaciens traversaient à pied la forêt afin
de donner des renseignements à des Allemands probablement infiltrés.
Pendant une semaine, on les garda en prison. Ils ont été libérés d’une
façon aussi illogique qu’ils avaient été arrêtés. Aucune intervention
en leur faveur n’avait eu lieu, pas même de la part de leur chef, juif,
de la SNCF à Paris.
Pourquoi nous sommes-nous installés à Provins ? Parce qu’il y avait
deux établissements d’enseignement secondaire, un pour filles, un autre
pour garçons. J’ai commencé le second trimestre, mais il n’y avait pas
de cours de grec, et je
faisais partie de ceux qui étudiaient le latin, puis le grec à partir
de la 3e. Ils ont été très gentils avec moi et ils ont regretté que je
ne sois pas leur élève depuis la rentrée des classes : ils auraient pu
faire leur emploi du temps pour que je puisse suivre les cours de grec
au lycée de garçons. Ceci n’était pas courant à cette époque, les
filles et les garçons ne fréquentaient pas les mêmes lycées. Nous
étions très bien considérés dans cette ville qui, depuis Rachi, ne
devait pas avoir l’habitude de frayer avec des juifs, surtout des juifs
qui observaient les règles, en particulier le Shabbat. Une fois par
semaine, Maman allait à Paris pour nous ravitailler en viande et
produits casher. J’allais à l’école dans les mêmes conditions qu’à
Strasbourg. Nous avions obtenu, sans difficulté, le droit de ne pas
écrire le samedi, mais nous avions un ennui supplémentaire, il était
également
interdit de porter le samedi. A Provins, je n’ai eu que des amis,
aussi bien parmi les élèves que parmi les enseignants.
Malheureusement, cette année scolaire ne se termina pas normalement. Au
mois de mai-juin, nous nous sommes retrouvés, comme beaucoup de
Français, sur les routes de France vers le Sud, pour échapper aux
Allemands qui commençaient à envahir et à occuper le Nord de la France.
On nous avait annoncé la proximité des troupes allemandes et, pris de
panique, nous nous sommes enfuis à pied, maman et les trois enfants.
Nous avons jeté nos bagages trop lourds dans le fossé, sur la route qui
devait nous mener à Vichy où étaient réfugiés des Juifs d’Alsace et, en
particulier, des amis, la famille Alexandre Klein. La plus jeune de
leurs neuf enfants (5 garçons et 4 filles), était Clairette ma
meilleure amie de Strasbourg. Ils nous ont reçus chez eux, nous et ce
qui nous restait comme bagages. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous
nous sommes aperçus que l’une des valises que nous avions jetées
contenait nos gobelets en argent. Paris tomba entre les mains des
Allemands. Au bout de quelque temps, nous avons pris un appartement
pour nous à Vichy. Papa, une fois de plus, en fonctionnaire sérieux, se
renseigna pour savoir où aller pour rejoindre son bureau. Seuls,
quelques collègues alsaciens non-juifs avaient refusé de retourner à
Strasbourg. En effet, après avoir annexé l’Est de la France, le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, l’Allemagne demanda aux Alsaciens
de revenir chez eux, mais il était interdit aux Juifs de le faire. Les
magasins, les commerces juifs, furent mis sous scellés et leurs biens
confisqués. Les Juifs restèrent donc dans la partie «non-occupée»,
dirigée par le Maréchal Pétain, vainqueur de Verdun contre les
Allemands pendant la guerre de 14-18.
Papa apprit que ses collègues avaient leur bureau à la gare de l’Est, à
Paris. Il se présenta et fut accepté. Au bout de quelques temps, les
administrations reçurent un ordre, émanant des Allemands, de renvoyer
leurs fonctionnaires juifs. La SNCF était devenue dépendante de l’État
français quelques années avant la guerre, mais avait conservé une
certaine autonomie. Elle exigea donc que ses fonctionnaires juifs qui
étaient en possession d’une «carte d’ancien combattant» ne soient pas
renvoyés. Papa en avait une et put ainsi rester à son travail. Il
possédait cette carte parce qu’il avait, en tant qu’Alsacien, été
mobilisé dans l’armée allemande… Après la victoire de 1918 et le retour
des trois départements à la France, celle-ci avait accordé aux
Alsaciens la même carte qu’aux Français.
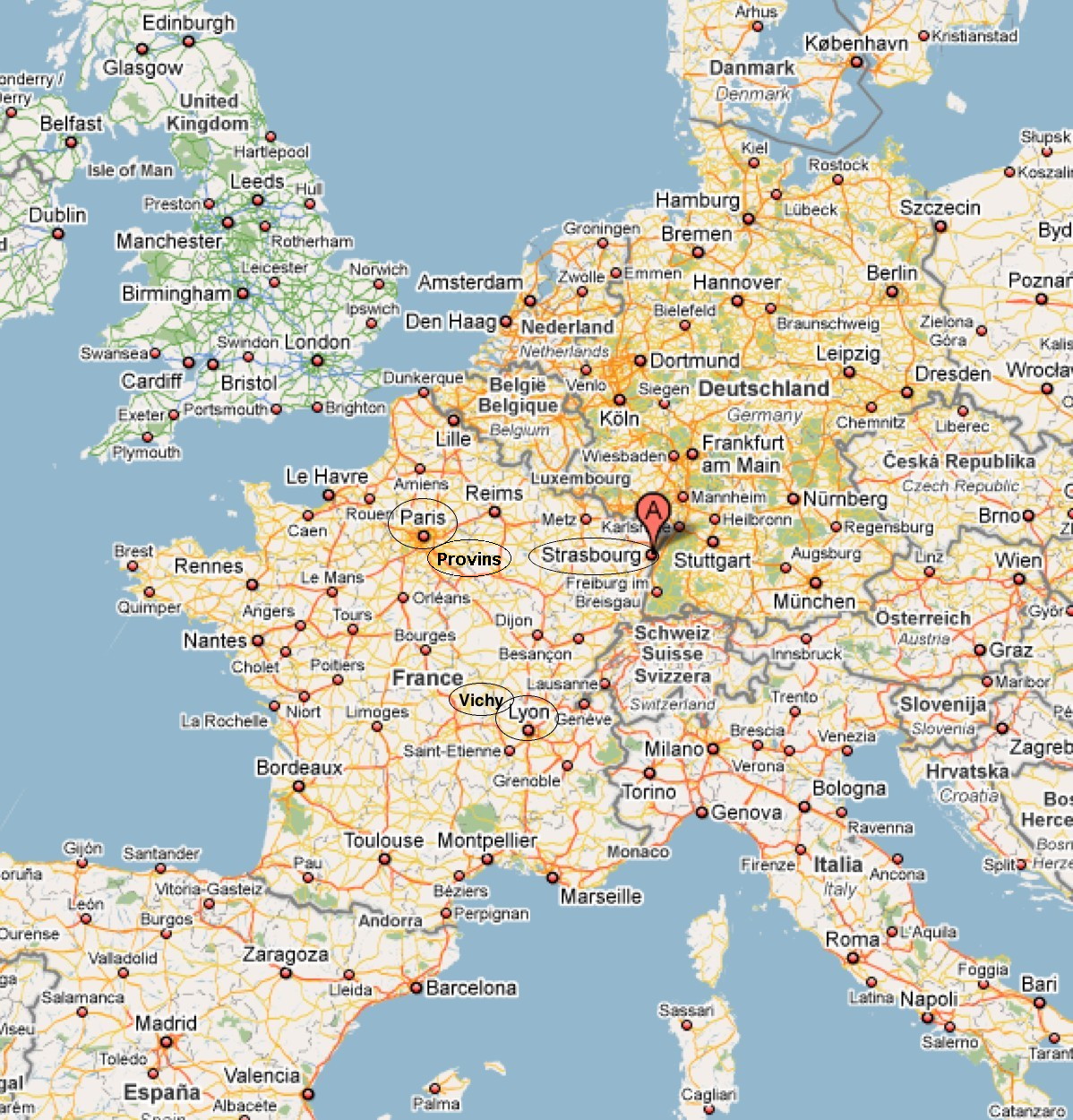
France:
Alsace (1924-1939) ; Hermé et Provins (1939-1940) ; Vichy
(1940) ; Paris (1940-1945) ; Lyon (1945-1946) ; Paris et
Versailles (1946-1948) ; Strasbourg (1948-1987).
Notre vie à Paris sous l'occupation allemande
Quelques semaines après, maman décida de rejoindre papa dans Paris
occupé. Cette décision en a choqué plus d’un. Malgré cela, elle est
partie avec ses trois enfants à Paris. Nous avons passé quelques jours
chez Madame Hertz qui avait encore sa petite pension près de la gare
Montparnasse. Nous nous sommes installés rue Poulet, dans le 18e, dans
une espèce de trou, deux pièces et cuisine. Le WC était sur le palier,
en commun avec les autres habitants de la maison. Le shabbat, il
fallait se faire accompagner par quelqu’un qui devait empêcher toute
personne d’entrer, car on ne pouvait pas fermer la porte sans
automatiquement allumer la lumière. De toute évidence, il devenait
urgent de nous inscrire, Éliane et moi dans un lycée. Le lycée
Lamartine était tout près de chez nous et, en plus, était dirigé par
une ancienne surveillante générale du lycée de Strasbourg qui nous
connaissait. Maman était sûre que tous nos problèmes, y compris ceux du
Shabbat, étaient de ce fait résolus. Quelle ne fut pas sa surprise
quand Mademoiselle Klein refusa de nous accepter ! C’était la seule
manifestation d’antisémitisme que nous avions eu à subir… (Je regrette
un peu de ne pas avoir porté plainte contre elle après la guerre…). Ma
mère nous a alors inscrites au lycée Jules Ferry qui avait eu des
élèves juives religieuses. Éliane entrait en quatrième et moi en
première et tout se passa bien avec les professeurs, l’administration
et les copines. Le seul problème que nous avions du mal à résoudre
était celui de porter des affaires le Shabbat, compte tenu qu’il nous
était interdit de laisser quoi que ce soit au lycée. Nous quittions les
dernières le vestiaire et nous cachions un petit sac sous le tablier
écru obligatoire, en espérant que personne ne le trouverait. Le jour de
la rentrée, je me suis trouvée à côté d’une autre nouvelle qui m’a
avoué être également juive. Elle s’appelait Marie-Claire Bernard et
nous sommes rapidement devenues amies. Les lois anti-juives n’étaient
pas encore promulguées, et un jour elle m’invita à l’accompagner à la
Comédie Française, voir Le Misanthrope. Elle avait reçu des billets par
son grand-père. Je n’ai su que bien plus tard que son grand-père était
Tristan Bernard… Tristan Bernard fut arrêté, mais ne quitta pas Drancy,
grâce à l’intervention de Sacha Guitry, qui était, lui, bien vu par les
occupants.
 La synagogue de la rue Cadet
continuait à fonctionner, sans le rabbin
Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier
en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer
de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le
proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que
cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés
à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de
grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,
proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être
arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un
passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas
réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon
du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…
La synagogue de la rue Cadet
continuait à fonctionner, sans le rabbin
Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier
en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer
de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le
proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que
cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés
à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de
grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,
proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être
arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un
passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas
réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon
du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…
Un jour, la Gestapo est venue pour arrêter Madame Hertz. Heureusement,
elle n’a pas ouvert et, par miracle, ceux qui devaient l’arrêter sont
repartis. Maman l’a installée ensuite chez nous, elle partageait notre
chambre, à Éliane et moi, séparée de nous par un paravent. Le lendemain
de cette «arrestation», Madame Hertz demanda à Éliane d’aller chercher
un peu de vaisselle dans son appartement (nous pourrions en avoir
besoin) et je devais la rejoindre pour l’aider à tout transporter.
Quelle inconscience ! A un certain moment, on a frappé à la porte et
Éliane eut la présence d’esprit de ne pas ouvrir – ce qui n’était pas
évident, elle aurait pu croire que c’était moi qui venais la chercher
comme convenu…
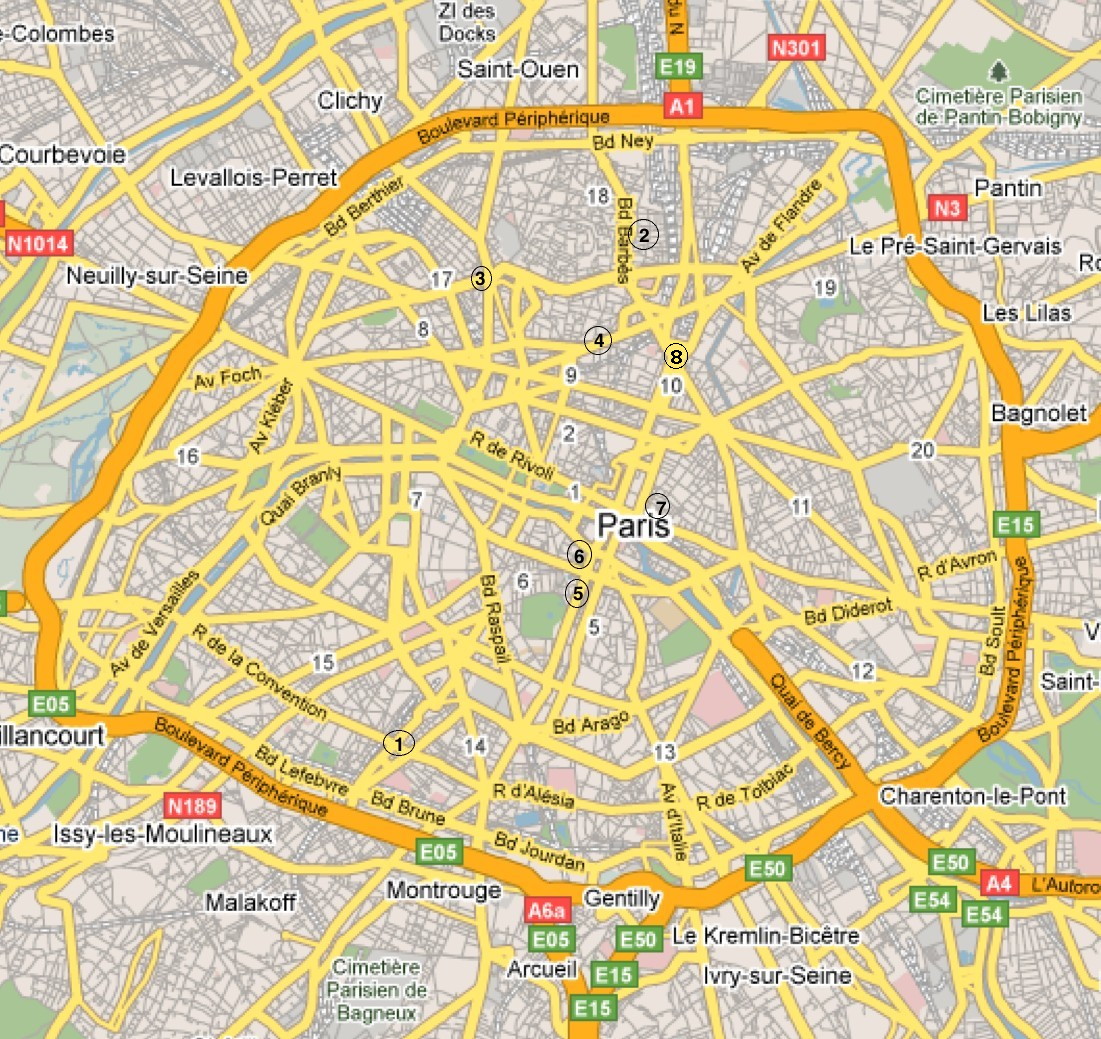
Paris : (1) Pension gare
Montparnasse ; (2) appartement rue Poulet ; (3) Lycée Jules
Ferry, bd de Clichy ; (4) Synagogue rue Cadet et appartement rue
Notre Dame de Lorette ; (5) université La Sorbonne, bd St
Michel ; (6) Lycée Fénelon, quartier latin ; (7) appartement
rue du Temple ; (8) Gare de l’Est.
À Paris, la concierge était l’une des
personnes les plus importantes… Votre sort dépendait d’elle. Combien de
juifs ont-ils été déportés à cause d’une concierge ? Nous, en revanche,
avons été sauvés grâce aux concierges et au silence de centaines,
peut-être de milliers, de personnes qui nous connaissaient dans le
quartier, en partie grâce à nos étoiles jaunes, les habitants des deux
maisons jumelles, les commerçants et les gens du quartier qui nous
croisaient dans la rue. C’est le moment de mentionner Monsieur et
Madame René, les concierges de la rue N-D de Lorette et leurs deux
enfants Aimée et Pierrot. Ils nous ont sauvés plus d’une fois. Un jour,
Madame René eut la visite d’un policier qui enquêtait sur l’appartement
des Munk:
- Qui occupe cet appartement ? demanda-t-il.
- Un Alsacien qui travaille à la SNCF.
Ce fut la réponse de Madame René qui ne manqua pas de calme et de
présence d’esprit. Cette réponse satisfit le policier qui repartit.
Qui, en effet, aurait pu s’imaginer qu’un Alsacien travaillant à la
SNCF pouvait être Juif ? Des incidents analogues se reproduisirent
plusieurs fois, y compris alors qu’Éliane se trouvait dans la loge pour
remplacer Madame René qui avait dû s’absenter…
Dans notre maison, rue N-D de Lorette, habitait une famille espagnole
qui avait fui l’Espagne à cause de Franco, ce même Franco qui a laissé
passer et reçu des Juifs dans son pays. Il y avait aussi un descendant
de Jean Jaurès à qui j’ai donné des leçons de latin. Eux, et toutes les
autres personnes qui habitaient la maison, ont su garder le silence.
Pourtant, notre présence n’était guère discrète. En plus de Madame
Hertz qui ne quittait pas la maison, nous recevions très souvent nos
cousins Pierre et Huguette Blum et Donald Simon dont les parents
avaient été déportés. Huguette et Pierre avaient fui Parthenay, dans
les Deux-Sèvres. Après l’arrestation de leurs parents, Idon, le cousin
de papa et sa femme Sara, ont été hébergés par un couple, Monsieur et
Madame Urbain, Place du Panthéon, jusqu’à la fin de la guerre. Nous
continuions notre vie de Juifs religieux. Plus de viande bien que,
pendant un certain temps, on ait maintenu un sacrifice rituel sous
anesthésie. Pour le reste, nous avions de quoi manger, grâce à la SNCF,
à des tickets de pain supplémentaires et à l’ingéniosité de maman qui
réussissait à faire une cuisine correcte avec ce dont nous disposions.
Tous les quinze jours, nous recevions un envoi de Bretagne grâce à
Albert Blum, le cousin de maman, qui nous expédiait des légumes et deux
volailles vivantes : elles devaient servir pour deux samedis. L’abatage
rituel était fait par Monsieur Falk, ancien chanteur de la synagogue de
Haguenau qui,
comme nous, était devenu « membre de la rue Cadet ». Un petit groupe de
fidèles a permis à cette Schoule de survivre pendant toute la guerre :
papa, le Dr Salomon Klein, Monsieur Falk, Monsieur Haacker, les anciens
de la rue Cadet, sauf ceux qui étaient partis en zone libre ou en
Suisse. Pour la fête des cabanes (Souccot), nous avions aussi une cabane - Éliane et moi y apportions les
repas à papa et au Dr Klein – je me souviens d’un énorme cédrat qu’une
connaissance nous avait envoyé de Monaco. La palme de dattier, nous la
gardions d’une année à l’autre, les branches de myrte, nous les
achetions en pot, et les branches de saule, Éliane et moi allions les
cueillir, tôt le matin, devant le Sacré-Cœur. Les matzot (le pain azyme), Monsieur
Haacker les achetait, tout à fait officiellement, contre des tickets de
pain pour toute la Communauté et les livrait à domicile. Un jour, il
fut arrêté dans le métro. Il avait un ballot de matzot sur le dos.
«Qu’avez-vous là ?» demanda l’agent. «Du pain de Juifs» répondit-il,
avec son accent alsacien très prononcé. Papa avait appris à lire la prière de la
Meguila, puisque nous ne pouvions plus sortir le soir pour assister à
un office. Il lisait et je faisais office de souffleur. Les seuls
écarts que nous nous permettions étaient les suivants : nous avions eu
l’autorisation de manger du fromage non casher, et pendant Pessah’, de
consommer du riz et des produits sans la certification qu’ils étaient «
casher le Pessah ». Le Shabbat, nous avions toujours des invités avec
lesquels nous partagions «le» poulet.
 Je
passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A
(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se
déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir
plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient
prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité
ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant
aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me
demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour
la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,
Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon
livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce
que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.
J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier
l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me
faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,
il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de
m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la
Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur
Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le
professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,
s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas
d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas
brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je
m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard
a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en
zone libre, après le bac.
Je
passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A
(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se
déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir
plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient
prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité
ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant
aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me
demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour
la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,
Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon
livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce
que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.
J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier
l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me
faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,
il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de
m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la
Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur
Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le
professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,
s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas
d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas
brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je
m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard
a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en
zone libre, après le bac.
Entre-temps, en plus du tampon JUIF
sur notre carte d’identité, on nous
avait imposé le port de l’étoile jaune. Pour obtenir ces «insignes», il
fallait faire la queue, payer et… donner des tickets de textile de
notre carte de rationnement ! Selon les autorités, les Juifs,
s’habillant et se nourrissant au marché noir, pouvaient bien dépenser
leurs tickets pour obtenir leurs étoiles !!! Le port de l’étoile était
obligatoire à partir de l’âge de six ans. Elle devait être cousue
solidement sur le côté gauche du vêtement extérieur, et les Juifs ne
pouvaient se rendre dans des lieux publics qu’avec l’étoile bien
visible. Le couvre-feu était fixé à huit heures du soir pour eux et ils
n’avaient le droit d’entrer et de faire leurs achats dans les magasins
qu’entre 16 et 17 heures. Autant dire qu’il ne restait pas grand-chose
dans les épiceries à cette heure-là. Le tout était d’être en bons
termes avec son crémier qui vous gardait alors votre ration… Éliane et
moi allions donc au lycée avec notre étoile et papa se rendait à son
bureau, muni de la sienne. Tous les jours, en arrivant sur la
passerelle qui enjambe la rue de Châteaudun, il croisait des
fonctionnaires allemands qui travaillaient également à la gare de l’Est.
Jamais nous n’avions eu d’aussi agréables camarades de classe et papa
nous disait la même chose de ses collègues. Ils étaient, disait-il,
d’une prévenance extraordinaire. J’aimerais rendre hommage aux
collègues de papa en racontant son programme, le Shabbat. Il était
évident que papa ne pouvait prendre congé chaque Shabbat. Il faisait la
prière du matin à la maison puis partait à son bureau où l’attendait
son livre de prière, commenté par Samson Raphaël Hirsch. Il étudiait
jusqu’à l’heure de la lecture de la Bible, qu’il écoutait dans la
Schoule de la rue Cadet. Il assistait ensuite à l’office, puis
repartait au bureau terminer son étude de la Sidra, jusqu’à midi. Tous
ses collègues savaient qu’il ne fallait en aucun cas lui téléphoner :
il ne répondrait pas. Son supérieur, Monsieur Collot (je crois que
c'était son nom) venait souvent bavarder avec lui, sachant qu’il ne
travaillait pas. Un Shabbat, alors que les deux hommes bavardaient dans
le bureau de papa, le téléphone se mit à sonner. Le chef décroche
l’appareil et se met à attraper celui qui était à l’autre bout du fil :
«Ne savez-vous pas que Metzger ne répond pas au téléphone le samedi ??!»
Le Shabbat après-midi, nous étions tous à la maison et c’est alors que
j’appris à jouer aux échecs. Mon professeur était mon amie Marguerite
Klein, fille de Moïse qui a été déporté en 1941 ou 1942. Marguerite est
restée avec sa mère, car ses deux frères étaient prisonniers en
Allemagne, et son oncle de Dr Salomon Klein, resté à Paris où il a pu
continuer d’exercer, rue d’Hauteville.
Après le bac de philo, je décidai de faire une année de préparation en
hypokhâgne au lycée Fénelon, dans le quartier Latin. J’y allais en
métro, deux fois par jour. Le dernier wagon du métro était le seul
autorisé aux voyageurs juifs. Combien de fois avons-nous piqué un cent
mètres pour arriver au dernier wagon, quand la rame entrait en gare en
même temps que nous. Mieux valait ne pas rater le métro car les rames
n’étaient, de loin, pas aussi fréquentes qu’aujourd’hui. Les stations
les moins importantes étaient souvent fermées. Le lycée Fénelon avait
des classes préparatoires pour les grandes écoles, réservées aux filles
seulement. Les garçons suivaient les cours du Lycée Henri IV, où se
trouvait mon cousin Donald, qui ne s’était pas déclaré comme Juif.
Je n’oublierai jamais l’année merveilleuse passée à Fénelon. Nous
étions deux juives, mais ma copine n’avait rien du judaïsme, sauf
l’étoile. Une seule de mes camarades du lycée Jules Ferry se retrouvait
avec moi, Pierrette Perret. Elle deviendra pour moi une amie
particulièrement dévouée. Je pense que la plupart de mes camarades ne
savaient pas exactement ce qu’était un Juif et ignoraient totalement en
quoi consistait la pratique du judaïsme. Je suppose que, pour la
première fois de leur vie, elles étaient en classe avec quelqu’un qui
n’écrivait pas le Shabbat. Elles découvrirent encore bien d’autres
comportements étonnants. Pour résoudre le problème de porter le
Shabbat, je demandais à Pierrette de m’aider. Elle accepta
immédiatement, sans demander d’explication devant ce comportement pour
le moins bizarre… et difficile à expliquer ! Le vendredi, je lui
confiais mes affaires pour le Shabbat, elle les apportait chez elle et
me les rapportait en classe le Shabbat matin. Elle les rapportait chez
elle après la fin de la classe et je les récupérais le dimanche ou le
lundi.
Un autre épisode concernait la pièce d’identité. Nous ne pouvions
circuler sans et nous ne pouvions la porter… comment faire ? Les hommes
mettaient parfois leur carte dans leur chapeau. Nous la mettions dans
la poche de notre vêtement, attachée par un trombone. Le chemin de la
rue N-D de Lorette jusqu’au Quartier latin était long : Faubourg
Montmartre, rue Montmartre, les Halles (plutôt encombrées), traversée
de la Seine du côté de l’île de la Cité… Ce qui devait arriver, arriva
: un Shabbat matin, rue Montmartre, j’ai été arrêtée par un policier
qui, me voyant les bras ballants et munie de mon étoile jaune, me
demande : «Vos papiers, mademoiselle !» Je les sors de ma poche, il les
regarde, me les rend en disant : «Excusez-moi, Mademoiselle, je voulais
seulement vous faire peur !» Il avait réussi. L’excuse était
maladroite, mais on fait ce qu’on peut !
Mais, revenons à mes camarades d’hypokhâgne. Elles m’entouraient de
leur gentillesse, avec beaucoup de délicatesse. C’est ainsi que,
lorsqu’elles formèrent le comité de classe, elles me nommèrent
immédiatement comme «Conservatrice des traditions». Pas mal, pour une
juive ! Voilà pourquoi, sur les photos, vous me voyez portant l’emblème
de khâgne, la chouette Vara. N’oubliez pas que la chouette est l’un des
attributs d’Athéna, la déesse de la sagesse, dans la mythologie grecque
dont nous étions toutes imprégnées. Ce furent des moments extraordinaires ! D'autres détails de
ma vie durant l’année 42-43 figurent dans le film de l'Institut Spielberg sur
les rescapés de la Shoah.
Au moment des vacances, pour la première fois, j’ai pleuré à l’idée de
quitter mes copines, dont je n’ai retrouvé qu’une petite partie à la
rentrée, sur les bancs de la Sorbonne. J’ai été acceptée à l’Université
car le numerus clausus n’était pas atteint, le nombre de Juifs
parisiens n’étant pas assez important. J’ai réussi mes examens de latin
et de grec, mais j’ai ensuite arrêté, pour une raison très simple : la
guerre finie, j’ai retrouvé le mouvement des jeunes «Yeshouroun» et son
chef, Bô Cohn...
Malgré la fin de la guerre, mes parents avaient décidé de ne pas
retourner à Strasbourg et papa a gardé sa place à Paris, à la gare de
l’Est. Le rabbin Munk était revenu immédiatement après la libération de
Paris. Il y avait retrouvé sa place… et son appartement de la rue N-D
de Lorette. Mes parents ont donc du quitter cet appartement pour
s’installer rue du Temple, près de la rue de Rivoli et de l’Hôtel de
Ville, pas loin de la Seine et du Quartier Latin et proche aussi du
quartier juif de la rue des Rosiers. Ils sont devenus de très bons amis
de la famille Munk, et ont continué à fréquenter la rue Cadet qui,
quoique étant presque à une heure à pieds de leur appartement, est
restée leur synagogue.
Après la fin de la guerre, nous avons été mis en face de l’horrible
réalité. Nous savions qu’il existait des camps pour les Juifs, mais
personne n’aurait pu imaginer, même en pensant au pire, ce qui s’était
réellement passé. Les déportés qui revinrent ne parlaient pas, pour de
multiples raisons. Nous apprîmes les noms de toutes nos connaissances
et amis qui ne reviendraient plus, sans pour autant pouvoir nous
imaginer quelle a été leur horrible fin. Ma meilleure amie et sa sœur
Mady en faisaient partie. Et, lentement, je me rendis compte qu’on ne
pouvait rien prévoir. Ceux qui ont survécu c’est par chance, grâce à
D., non par intelligence ni parce qu’ils avaient un mérite particulier,
comme certains rabbins ont essayé de nous faire croire, encore bien
après la guerre. Je pense très souvent à mon amie Clairette. Quand
maman a décidé de quitter Vichy pour rejoindre papa à Paris, Clairette
a fait une scène terrible, prétendant que mes parents nous amenaient
dans la gueule du loup. Elle avait parfaitement raison. Cependant, la
raison et le bon sens ne l’ont pas emporté. Clairette et sa sœur Mady
se sont inscrites à l’Université de Strasbourg repliée à
Clermont-Ferrand. Le jour de la rafle à l’université, elles se sont
fait arrêter, déporter, et ne sont plus revenues… Nous, nous avons
survécu à Paris, dans la gueule du loup.
Deuxième partie (1945-2006)



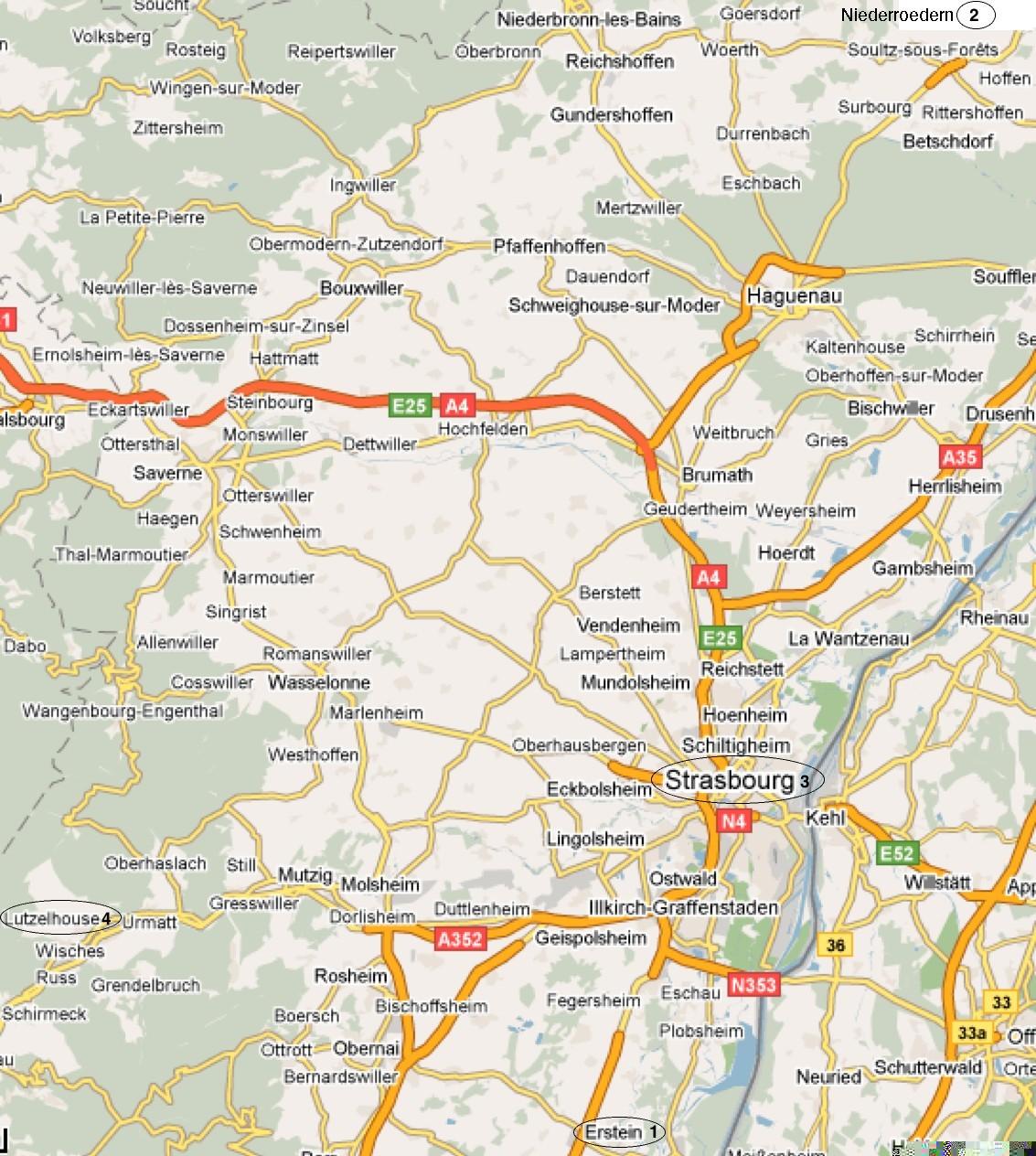
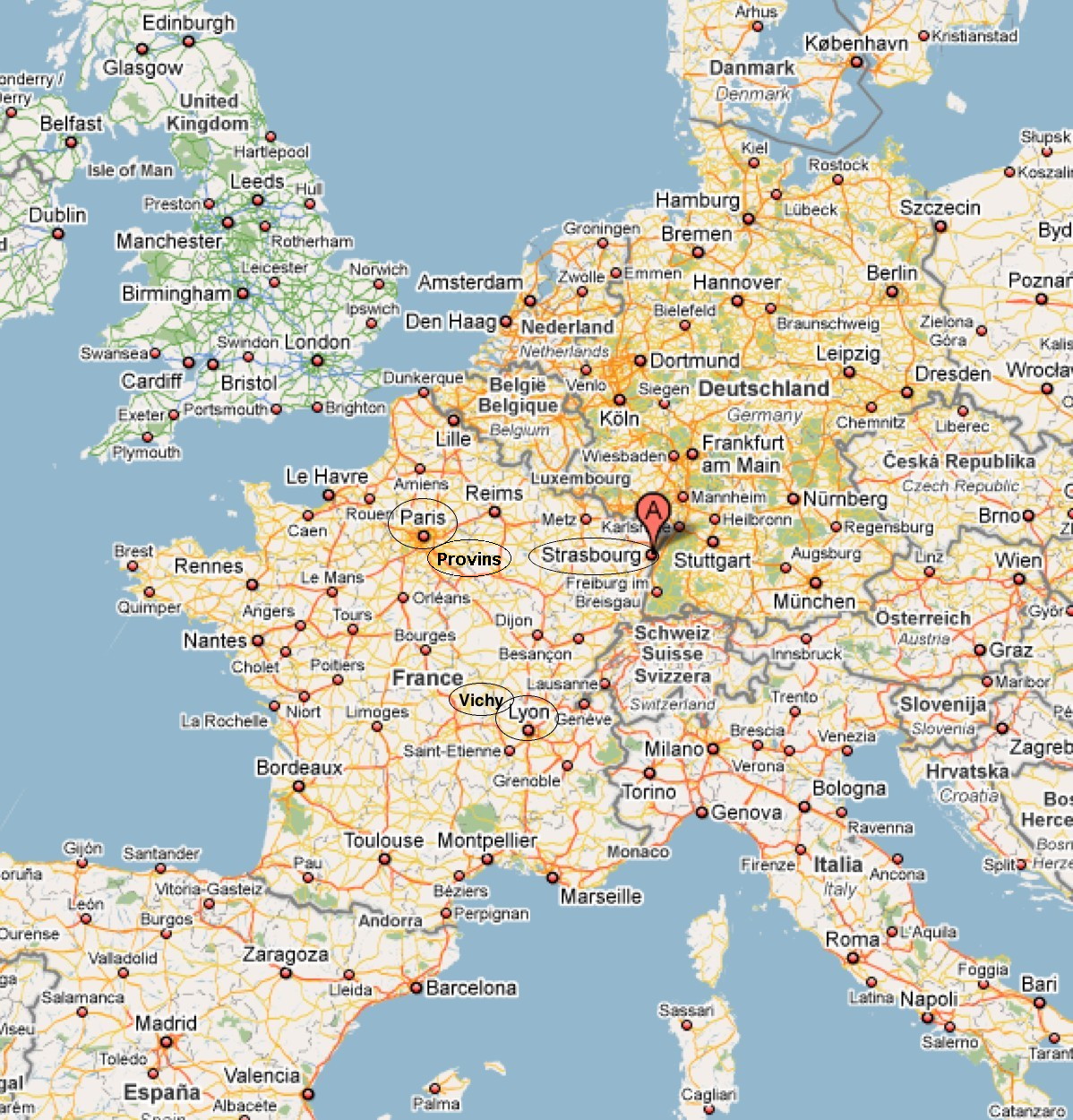
 La synagogue de la rue Cadet
continuait à fonctionner, sans le rabbin
Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier
en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer
de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le
proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que
cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés
à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de
grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,
proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être
arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un
passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas
réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon
du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…
La synagogue de la rue Cadet
continuait à fonctionner, sans le rabbin
Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier
en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer
de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le
proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que
cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés
à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de
grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,
proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être
arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un
passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas
réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon
du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…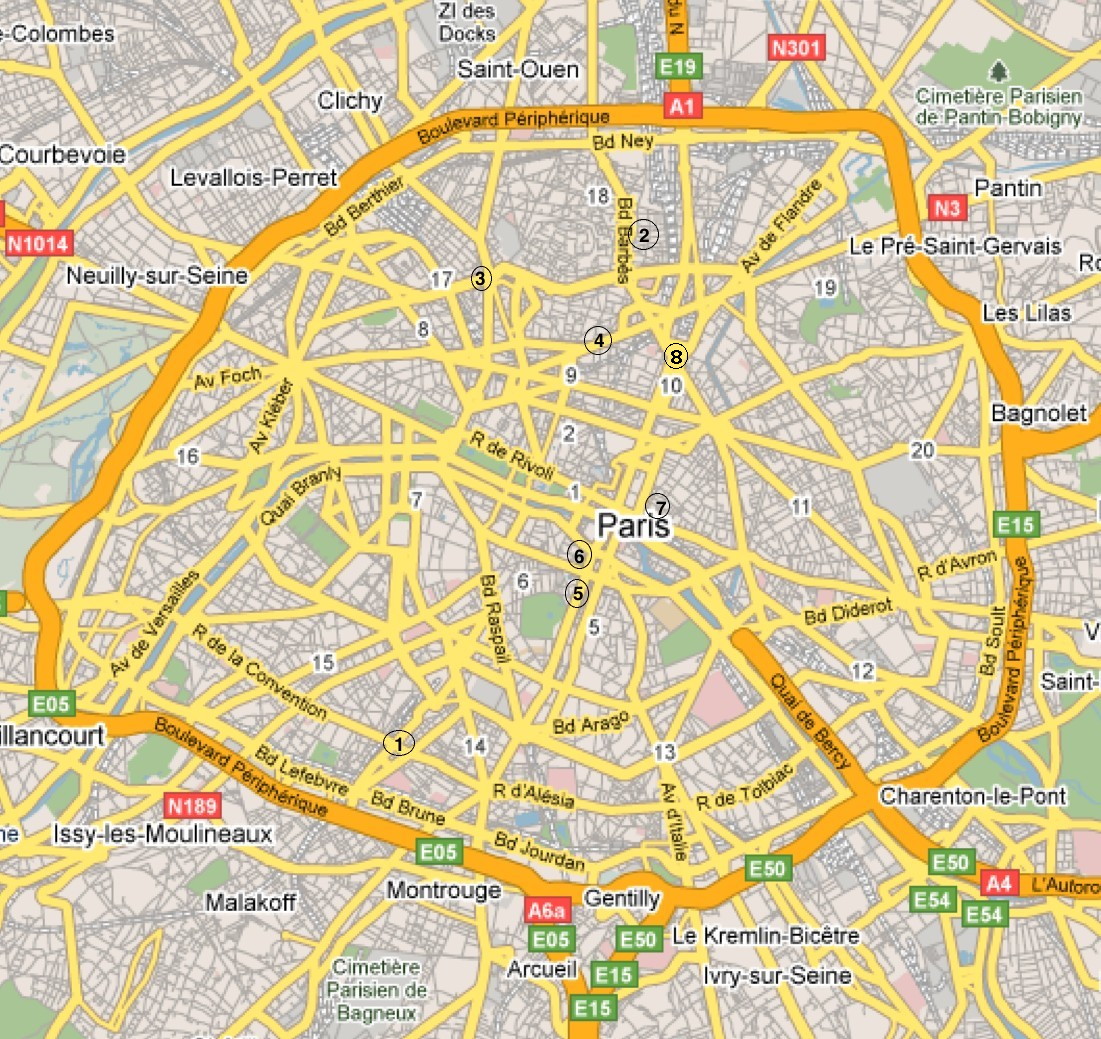
 Je
passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A
(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se
déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir
plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient
prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité
ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant
aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me
demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour
la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,
Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon
livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce
que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.
J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier
l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me
faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,
il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de
m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la
Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur
Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le
professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,
s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas
d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas
brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je
m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard
a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en
zone libre, après le bac.
Je
passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A
(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se
déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir
plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient
prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité
ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant
aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me
demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour
la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,
Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon
livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce
que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.
J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier
l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me
faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,
il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de
m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la
Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur
Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le
professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,
s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas
d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas
brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je
m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard
a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en
zone libre, après le bac.